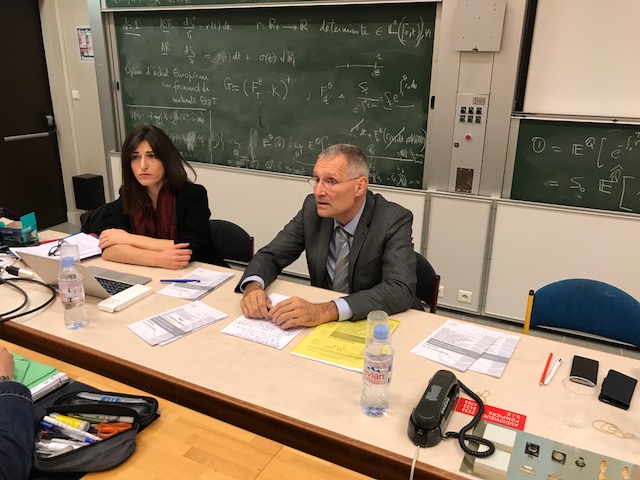Article 2 Bis et 2 Ter
À partir du 6 mars, le Sénat a débattu de 2 articles ajoutés après l’Article 2, proposés par les rapporteurs (LR) de la Commission des Affaires Sociales et du projet de loi. Ces ajouts concernent la mise en place d’un « contrat fin de carrière » à destination des séniors. Le dispositif engendre des exonérations de cotisation « famille » pour l’employeur, ce qui créera une nouvelle baisse de recettes pour la Sécurité Sociale. L’argument budgétaire était pourtant pour le Gouvernement, le fondement de cette réforme injuste. Aussi, l’employeur pourra mettre un terme unilatéralement au contrat si le salarié remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (ce qui n’était jusque là possible qu’à partir de 70 ans). Le caractère « indéterminé » de la durée de ce contrat semble donc parfaitement relatif. Le sénateur Franck Montaugé et l’ensemble des groupes de gauche s’y sont opposés pour ces raisons, préférant une réforme structurelle de l’emploi des séniors et non une « mesurette » qui ne bénéficiera ni aux intéressés ni à la Sécurité Sociale.
Les amendements proposés par le groupe Socialiste Ecologiste et Républicain (SER) ont été rejetés. Les articles 2 BIS et 2 TER instaurant ce dispositif ont été adoptés à 202 contre 123 voies démontrant qu’une partie des centristes s’y est opposée.
Article 3
Cet article annule le transfert aux URSSAF de l’activité de recouvrement des complémentaires retraites (Agirc-Arrco). Ce mécanisme avait été décidé lors de loi de finances pour 2023 et malgré l’opposition des groupes de gauche au motif de sa complexité et de son utilité très nuancée. Le Gouvernement a donc décidé de revenir en arrière et de rétablir le fonctionnement initial de recouvrement de créances.
L’article a été voté à l’unanimité.
Article 4
L’examen de la réforme s’est ensuite orienté sur le tableau d’équilibre des régimes obligatoires de la Sécurité Sociale, pour l’année 2023. Ces lignes budgétaires rendent compte de la doctrine conservatrice du Gouvernement qui fait peser sur les charges de la Sécurité Sociale les exonérations de cotisations et les nombreuses aides distribuées aux grandes entreprises durant le COVID, trop souvent sans contrôle et avec effet d’aubaine. L’exécutif utilise ensuite ce déséquilibre délibérément créé pour justifier l’allongement du temps de travail. Le sénateur Montaugé (Lire son intervention ICI) et son groupe s’y sont donc opposés, considérant qu’« un autre pilotage est possible ».
L’article a été adopté par la majorité sénatoriale.
Article 5
L’article 5 fixe l’objectif d’amortissement de la Caisse D’amortissement de la Dette Sociale évalué à 17,7 milliards d’euros pour 2023. Créée en 1995 par le Gouvernement d’Alain Juppé, la CADES est détournée de sa vocation première depuis pour financer la Sécurité Sociale. Cette dette est devenue le moyen privilégié par l’Etat pour imposer coupes budgétaires et austérité sociale. Le Gouvernement l’utilise aussi pour justifier la réforme des retraites sur le motif budgétaire. Les groupes de gauche et Franck Montaugé s’y sont opposés (Lire sont intervention ICI).
La droite sénatoriale a adopté l’article, en toute convergence avec le Gouvernement.
Article 6
L’examen de l’Article 6 a débuté le 6 mars. Dernier article des dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre de la Sécurité Sociale, cet article fixe les prévisions budgétaires des régimes obligatoires jusqu’en 2027. Là encore, les équilibres annoncés par le Gouvernement justifient a posteriori cette prévision. Ces projections sont annexées au projet de loi au sein d’une étude d’impact lacunaire qui ne fait pas état des enjeux macro-économiques de la réforme liés à la croissance, à l’emploi ou au chômage. Ce document ne mentionne pas non plus les conséquences sociales qui aggraveront par exemple les inégalités homme-femme. La faiblesse de cette étude d’impact et l’absence d’analyse sur les effets structurels de la réforme ont fondé l’opposition du groupe SER et celle du sénateur Franck Montaugé qui en a demandé la suppression par un amendement (lire son intervention ICI).
L’article 6 a été adopté le 7 mars.
La première partie du projet de loi de financement rectificative a été adoptée à 236 voies contre 102.
Article 7
La seconde partie du projet de loi et plus particulièrement l’Article 7 intéressent le recul de l’âge de départ à la retraite, mesure centrale du projet de réforme. Les 181 alinéas concernent donc l’allongement du temps de travail pour la majorité des salariés, fonctionnaires, employés civils et militaires et fonctionnaires de police. Le recul de l’âge de départ est une mesure injuste et injustifiée au regard des prévisions du Conseil d’Orientation des Retraites qui n’estime pas notre système des retraites en danger sur le long terme. Un autre pilotage est possible pour combler le décrit prévu qui sera d’ailleurs conjoncturel mais que le Gouvernement utilise pour sa politique socialement régressive. Le sénateur Montaugé s’y est opposé lors d’une prise de parole sur l’article (lire son intervention ICI).
Il a ensuite défendu un amendement tendant à la suppression de cette mesure (Lire ICI).
Au terme d’une discussion nourrie sur l’inopportunité de la mesure, la droite sénatoriale a usé de stratagèmes parlementaires permis par le règlement du bureau (article 38) pour accélérer les débats et conclure rapidement par le vote de l’article 7. A cette fin, la Commission des Affaires Sociales a fait adopter un amendement de réécriture de l’Article 7 présenté par le rapporteur LR du projet de loi. Cet amendement, à dessein introduit pour perturber le processus de discussion, a ensuite permis de supprimer sans présentation ni débat près de 1100 amendements préparés par l’ensemble des sénateurs des groupes d’opposition.
Enfin la commission des affaires sociales a rejeté en quelques minutes sans vraiment les examiner au fond et avec des motifs fallacieux les sous-amendements à l’amendement introduit par le rapporteur de la loi. Ces sous-amendements reprenaient, logiquement, les amendements initialement validés par la commission des affaires sociales puis supprimés unilatéralement par la majorité sénatoriale.
Cet incident majeur de procédure alimentera les recours formulés auprès du Conseil Constitutionnel au terme du débat sénatorial en cours de ce texte.
En plus d’une discussion restreinte par la procédure choisie par la Gouvernement au titre de l’Article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement et la droite sénatoriale ont de concert empêché les parlementaires de s’exprimer sur les amendements supprimés à l’article 7 du projet de loi.
Le sénateur Franck Montaugé n’a donc pas pu défendre ses positions sur diverses dispositions dont les français seront victimes. Vous les retrouverez ICI.