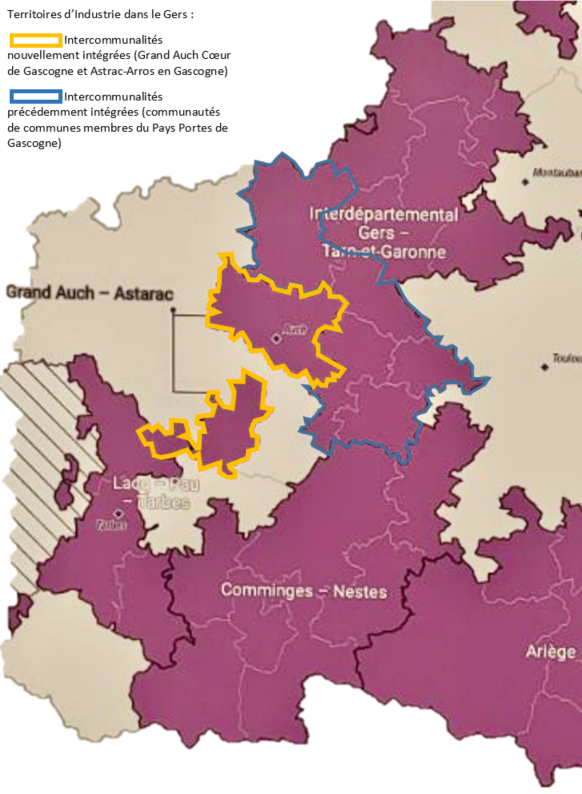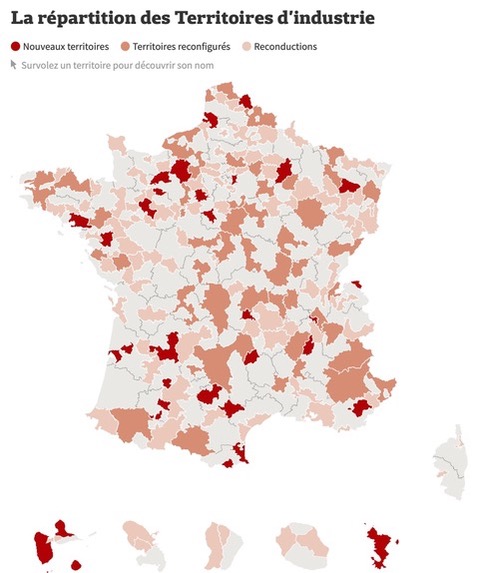Le sénateur Montaugé s’est exprimé ce mardi 21 novembre 2023 en conclusion d’un débat sur le thème : « Déclinaison territoriale de la planification écologique : Quel rôle et quels moyens pour les collectivités locales ? Quel accompagnement du citoyen ? ».
« Je remercie au nom de mon groupe nos collègues qui ont animé ce débat.
La transition écologique et énergétique est désormais le cadre d’action des collectivités territoriales et plus largement notre horizon commun en matière d’intérêt général.
Les collectivités vont devoir augmenter considérablement leurs investissements si nous voulons atteindre les objectifs nationaux et européens, dans le cadre de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC).
Depuis 2017, l’État a mis beaucoup de temps pour formaliser la planification écologique nécessaire à la définition du cadre d’action publique. Je salue le travail qui a été réalisé par le Secrétariat Général à la Planification Ecologique (SGPE).
Cela dit, beaucoup reste à faire ! Et de nombreuses questions restent en suspens.
J’en évoquerai deux pour conclure, majeures : le financement des politiques publiques de transition écologique et la méthode pour garantir une action globalement efficiente.
D’ores et déjà, il est indispensable de s’assurer que les collectivités territoriales auront une capacité financière suffisante, dans la durée, pour mener à terme les projets.
Ce point est absolument central !
Pour financer leur action en matière de transition écologique, les collectivités devront composer avec :
- le recours à l’emprunt, à des niveaux inhabituels,
- la réorientation de certains de leurs choix d’investissement vers la transition écologique,
- l’augmentation de leurs ressources propres par le biais des politiques tarifaires, de prélèvements sur leurs fonds de roulement ou de ce qu’il reste de fiscalité.
- et les soutiens financiers de l’État, hypothétiques, seront essentiels pour mobiliser la Nation.
Aucun de ces leviers n’est facile à utiliser, ils devront être combinés.
En réalité, La situation nécessitera plus que des ajustements ponctuels.
Il ne faut pas se mentir, le mur des investissements climat obligera à reconsidérer la structure de l’équilibre financier issu de la décentralisation.
On ne passera pas facilement de 55 milliards d’€ d’investissement aujourd’hui à 80 milliards en 2030. (Chiffres extraits du rapport récent de l’Institut pour l’économie du climat I4CE)
À partir de ce constat, quelles sont les difficultés à traiter ?
D’abord le rapport des collectivités à l’endettement est très variable suivant le type et la taille des collectivités. La nécessité d’emprunter au-delà des niveaux habituels, parce qu’il le faudrait, sera pour certaines un frein.
Ensuite, les collectivités devront faire des arbitrages entre actions – climat et investissements plus classiques. C’est un chantier qui restera difficile tant qu’il n’existera pas avec l’État une vision partagée du sujet.
Nous considérons que le renforcement des soutiens de l’État aux collectivités est indispensable pour la réussite nationale en matière climatique.
La nécessité de redresser les comptes publics n’exonère pas l’État d’aides aux collectivités pour réussir la transition climatique.
L’évaluation et la revue des politiques publiques spécifiques de l’État devraient permettre de trouver des économies en même temps que des ressources tout en améliorant les services publics. Mais l’indexation de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) sur l’inflation – qui n’est pas prévue – et la pérennisation du « Fonds vert » à 2 et même 2,5 milliards d’euros par an ne suffiront pas à résoudre l’équation financière de l’action climatique des collectivités locales.
Pour bien mesurer les conséquences, les projections indiquent que l’encours de dette des collectivités augmenterait de plus de 77 milliards d’euros en 2030 par rapport à 2022.
Et à système fiscal constant, l’aide de l’État sera d’autant plus décisive que la diminution structurelle des ressources des Régions et des Départements est dès aujourd’hui forte avec des conséquences sensibles sur les aides futures à l’investissement du bloc communal.
Notre système de fiscalité locale est-il adapté aux besoins de financement de la transition écologique ?
La réponse est non ! Le Gouvernement est aussi attendu sur ce point.
Le « programme de stabilité » présenté à la commission européenne, la « loi de programmation des finances publiques 2023-2030 » devraient être en ligne avec les besoins de financement des collectivités locales.
Ils ne le sont pas !
L’État connait-il bien le niveau des « investissements climat » qui incomberont aux collectivités locales ? J’en doute. L’expertise de M. Pisani-Ferry / Mme Mahfouz pourrait être utilement sollicitée.
La « loi de programmation pluriannuelles des finances publiques » que nous appelons de nos vœux clarifierait ce point.
Et je termine sur la méthode.
La relation État – collectivités doit être opérationnellement adaptée à la transition écologique.
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE), les contrats pluriannuels d’objectifs et de performance (COP) et autres instances de ce type ne suffiront pas… s’ils ne constituent pas des facteurs de complexité accrue !
C’est d’un accompagnement opérationnel que les collectivités ont besoin, de l’ingénierie qui demandera des ressources spécifiques non disponibles aujourd’hui, à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et jusqu’à l’évaluation de la performance climatique des projets réalisés.
Le dialogue entre État et collectivités doit être réinventé en se basant sur des revues de plans pluriannuels d’investissement (PPI) cohérents avec les possibilités locales de financement et les objectifs « climat » retenus. La réussite de la transition écologique du point de vue des collectivités passera par des moyens adaptés et une refonte du dialogue et de la gestion de projets avec l’État.
L’amélioration du « pouvoir de vivre » des plus modestes de nos concitoyens devra aussi être conjuguée avec l’action climatique d’intérêt général. La politique climatique doit être développée dans la Justice sociale. Je vous remercie. »