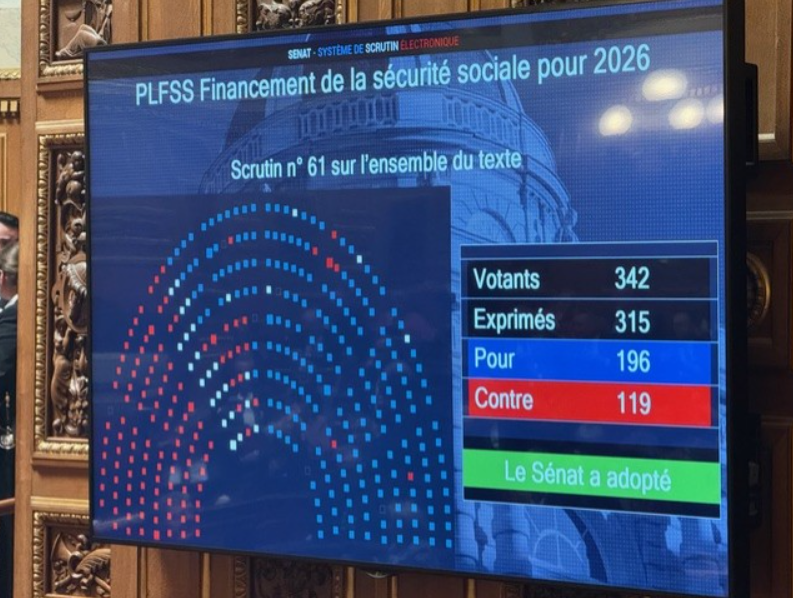Franck Montaugé et les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) ont voté pour une proposition de résolution européenne visant à demander au gouvernement de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (UE) pour empêcher la ratification de l’accord avec le Mercosur.
Sur le fond, ils dénoncent un accord d’un autre temps qui met en péril l’agriculture et la souveraineté alimentaire française ainsi que le climat. Sur la forme, ils pointent du doigt la méthode de la Commission européenne qui contourne les parlements des Etats-membres de l’UE.
Alors que les agricultures française et européenne traversent une crise inédite, l’accord UE-Mercosur organiserait une ouverture massive aux importations agricoles sudaméricaines et exercerait alors une pression supplémentaire sur les prix, mettant péril des exploitations déjà asphyxiées. Il sacrifierait l’agriculture au profit d’intérêts industriels.
Cet accord va à rebours des engagements climatiques pris et de la lutte contre la déforestation. Son impact environnemental est incompatible avec le Pacte vert européen, la stratégie « de la ferme à l’assiette » et les objectifs que l’Union européenne prétend défendre sur la scène internationale.
Les garanties avancées par la Commission européenne (clauses de sauvegarde, contrôles sanitaires renforcés, mesures miroirs) ne sont que des promesses sans engagement réciproque. Sans renégociation avec les pays du Mercosur, ces mécanismes seront inopérants.
Au-delà de ces désaccords de fond, Franck Montaugé et ses collègues dénoncent la volonté de la Commission européenne de contourner un vote à l’unanimité au Conseil en scindant d’autorité l’accord. Cela pose un véritable problème démocratique : un accord aux conséquences aussi lourdes pour l’agriculture, l’environnement et les droits humains ne peut être imposé sans un véritable débat parlementaire et sans le consentement des peuples.
Dans un contexte d’isolement diplomatique de la France et d’absence de minorité de blocage au Conseil, il reste un dernier levier : la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle est aujourd’hui indispensable pour clarifier le cadre juridique de cet accord et empêcher sa ratification précipitée.
Les sénatrices et sénateurs du groupe SER demandent un changement de cap. Ils réclament une réorientation radicale des accords commerciaux qui doivent être des outils au service de nos intérêts stratégiques. Il est urgent de repenser notre modèle d’échanges commerciaux, de replacer la légitimité démocratique en son centre et d’agir pour des accords ambitieux et respectueux des droits sociaux et de l’environnement.
Alors que le fossé règlementaire et normatif qui sépare nos deux continents est abyssal, outre les agriculteurs, ce sont également les consommateurs – via la qualité des produits importés – qui pâtiront de cet accord.